Comment éviter de dépenser son énergie inutilement et être efficace lorsque l’on a un enfant difficile ? Que l’enfant soit difficile ou non, voici quelques conseils de bases pour les parents.
Lire la 1ère partie de l’article.
Fixer des objectifs prioritaires
Il s’agit de déterminer des objectifs prioritaires et de renoncer à vouloir solutionner tous les comportements difficiles à la fois. On commence par faire la liste des comportements de l’enfant qui sont les plus dérangeants (il est agité et agressif, mais c’est l’agressivité qui est la plus pénible à gérer) et les moments de la journée qui sont les plus délicats à négocier (par exemple le bain à la maison et le rang à l’école).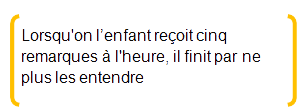
La liste peut être longue et c’est l’occasion de se rendre compte qu’on est constamment « sur le dos » de l’enfant, à le réprimander. Or, lorsqu’on reçoit cinq remarques à l’heure, on finit par ne plus les entendre… c’est un phénomène normal d’habituation (tout comme si vous habitez à côté d’une voie ferrée où passent vingt convois par jour, vous finissez par ne plus les entendre et vous pouvez douter du fait que celui de 9hl3 est bien passé comme d’habitude !). Il faut donc, dans un deuxième temps, sélectionner dans la liste entre un et trois comportements-cible, pas davantage, qui feront l’objet d’une stratégie et d’une attention particulières.
Méthodologie pour définir les bonnes priorités
Pour aider à faire un choix parmi les situations qui posent problème, il est conseillé de classer les comportements difficiles qu’on a identifiés en trois colonnes : les « totalement inacceptables », les « embêtants mais tolérables pour l’instant » et les « tolérables sur un plus long terme ».
Il faut commencer par choisir dans la première colonne et faire l’effort de laisser momentanément tomber les autres. L’objectif est d’une part de diminuer le nombre de remarques adressées à l’enfant et, d’autre part, de vous permettre de concentrer vos efforts éducatifs sur un comportement (maximum trois) à la fois. Et vous, et l’enfant, aurez ainsi l’impression d’avoir des journées moins pénibles.
Outre la mise en trois colonnes, le choix doit être guidé par les valeurs et les priorités propres à chacun. Imaginons qu’entre autres choses désagréables, un enfant saute dans les canapés à la maison. Pour certains parents, faire cesser ce comportement constituera un objectif prioritaire parce que l’achat des canapés était un rêve et qu’ils ont épargné durant des mois pour se les offrir. Pour d’autres, qui se servent de vieux canapés récupérés chez un oncle décédé, l’enjeu sera inexistant et ils préféreront se focaliser sur d’autres comportements problématiques. Chacun, mère, père et enseignant, doit pouvoir exprimer ce qui le dérange le plus, lui en particulier.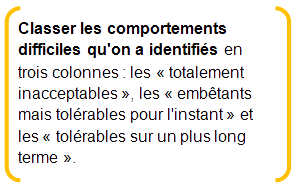
Enfin, le choix des comportements à cibler pourra être guidé par le degré de collaboration entre parents et enseignant. Il sera en effet plus efficace de s’attaquer d’abord à des comportements difficiles qui s’expriment dans les deux contextes (famine et école). Cela permet de décider de moyens éducatif; et de stratégies de renforcement communs.
Évaluer les progrès
Un dernier conseil général est qu’il faut prendre le temps d’évaluer ce qu’on a décidé de faire. Imaginons que l’on ait bien identifié le comportement qu’on vise à améliorer, et les moyens d’y parvenir,… il faut aussi s’assurer que ça marche, que l’on progresse. Or si on s’appuie uniquement sur ses souvenirs, cette évaluation sera forcément un peu faussée. Les mauvais souvenirs sont en effet plus saillants ; on les retient mieux, ils prennent plus de place dans notre mémoire.
On peut alors avoir la fausse impression que ce qu’on fait ne sert à rien, ce qui n’est pas forcément vrai ! Évaluer permet de vérifier si on progresse et à quel rythme. Pour cela, il faut par exemple noter, chaque fois que la situation se présente, si on a réussi à contenir ou non le comportement de l’enfant, et comment on s’y est pris. On peut ainsi vérifier notre propre cohérence dans le temps. Évaluer permet de garder courage, car réguler le comportement d’un enfant difficile peut prendre du temps…
Lire la 1ère partie de l’article.
Source et texte : Isabelle ROSKAM
Université de Louvain UCL – Institut de recherche en sciences psychologiques
|

